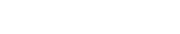Je ne sais si l’un d’entre nous parviendra à reconquérir cette place si singulière de la représentation de la musique par la peinture. La photographie y a gagné ses lettres de noblesse, vampirisant le sujet et ne laissant qu’une part congrue, généralement illustrative, à la peinture ou au dessin.
Bien sur, cette toile est aussi une nature morte jubilatoire : reproduire la forme de l’Esquire de Judah BauerBallroom ou de la Teisco E75 de Jon Spencer fut plus proche des plaisirs intenses d’un gamin à dessiner une pochette d’album de ses idoles que d’une élaboration conceptuelle pointue. Se procurer les instruments, les disposer de façon adéquate, reconstituer la scène jonchée de câbles dans l’atelier, batterie comprise, je serai bien en peine de nier mon plaisir.
C’est aussi une reconstitution, celle d’un concert des Blues Explosion au Ballroom de New-york à la fin des années 90. Une révélation pour moi et le maigre public survivant d’une journée de pluie drue. Plus de dix ans après, j’essaye donc de retrouver des documents proches de mes impressions sans affadir mes souvenirs, de matérialiser la nonchalance lumineuse de Judah Bauer, la sauvagerie de Spencer et la densité de Russel Simins, de m’emparer d’archétypes incarnés, d’attitudes devenues morphologies, de sons devenus formes.
La mise en place fut facile lorsque je me décidai à tendre l’horizon au niveau des genoux des musiciens, nos regards étant généralement à cette hauteur dans les salles où se produisent ce genre de groupes (plus le groupe gagne en notoriété, plus la ligne du sol rejoint celle de l’horizon, comme dans un tableau de Véronèse).
La géométrie de la batterie (ronds) et des amplis (rectangles) établit l’arrière plan tandis que les lignes tortueuses des câbles prolongent le sol jusqu’au premier plan. Une colonne de lumière orange pour intensifier les noirs et rythmer la composition (merci Barnett Newman) et le tour semblait joué.
Là, les ennuis commencèrent. Si le batteur (Russel) vint par miracle, la mise en place du personnage de droite (Jon), bouleversa l’échelle de celui de gauche (Judah).
Le point de vue du spectateur étant légèrement à la gauche du milieu de la toile, en face du batteur, le personnage de Jon, un peu plus éloigné, devait logiquement être légèrement plus petit que celui de Judah, campé au premier plan. J’avais fait exactement l’inverse ! La distance premier plan/arrière plan (Judah/Russel), soulignée par les câbles au sol, demandait, elle aussi, une modification de l’échelle de Judah. Il fallait donc étirer le corps vers le haut, accentuer la contre plongée (agrandir les jambes par rapport au tronc), remonter la guitare et sacrifier le visage désormais installé au niveau du thorax.
La Telecaster eu d’abord un deuxième manche… trop haut, un troisième, intermédiaire, un micro de moins et un corps de guitare qui tenta de suivre les pérégrinations du bassin du guitariste dont je n’arrivais pas à trouver la jambe d’appui.
Au lieu d’un camé magnifique à la « nonchalance lumineuse », je me retrouvais avec un Averell à petite tête et grand tronc, bénéficiant de deux mains supplémentaires très utiles pour un prototype improbable d’Esquire à triple manche : une réussite.
Des guitare comme la Telecaster ou l’Esquire sont des standards dont la moindre faute de proportion est facilement repérable pour qui s’est un peu intéressé à la musique ces cinquante dernières années, et une erreur de perspective, aisée à commettre sur des formes arrondies, donne rapidement une impression de guitare molle assez pathétique.
Mais remettre la guitare à la bonne hauteur et au bon angle fut une promenade de santé en regard du visage de Judah. Le personnage vieillissait et rajeunissait au gré de l’influence d’un récent concert au Trianon, de maigres documents glanés sur les pochettes, et de mes souvenirs plus anciens du Trabendo et du Ballroom.
Quinze ans de trop, puis un visage trop mièvre (et non raphaélesque, comme l’évoquait mes souvenirs) avant de me rendre compte que, campé sur la jambe droite, Judah s’était cambré et que dorénavant la tête devait basculer de trois centimètre sur la gauche si je voulais représenter l’ondulation de sa foutue « nonchalance lumineuse » et non un bête piquet. Rebelote !
Cela tournait au cauchemar : tout le tableau était désormais abouti, sauf le personnage de Judah : un vrai réfectoire Florentin(°). A force de refaire son visage, d’y croire, d’être lucide, de le raboter, de le refaire à nouveau, mes souvenirs s’estompent et j’en viens à douter que tout le projet ne soit pas une hérésie.
Après une dernière journée où, comme les précédentes, je rebadigeonne le résultat, je m’accorde une dernière tentative dans la demi heure qui me reste en faisant pivoter le visage vers le bas… Tout d’un coup, même esquissée, l’expression que je cherchais apparaît. Je travaille rapidement dans le demi frais et abandonne le terrain.
Je suis légèrement anxieux lorsque je rentre dans l’atelier le lendemain matin, mais soulagement, la justesse du visage est toujours là. Trop grand aussi, de peu, mais trop grand quand même… Restons calme !
Je ré-agrandis le corps (tout plutôt que de passer encore une semaine avec la créature de Frankenstein), j’élargis le torse, redescends l’Esquire (ce n’est pas une guitare mais un ascenseur), baisse les genoux et supprime les pieds (tant pis) et enfin : Judah est là, Alléluia !
Gilles Marrey
Texte paru dans le catalogue « Le Salon noir », éditions Actes Sud, 2012