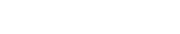Gilles Marrey est né en 1963. Il s’est formé à l’école des Beaux-Arts de Rouen dans les années 1980, de 1982 à 1988 pour être exact. Cette école à l’écart lui a permis d’échapper à l’académisme de l’art postmoderne du temps, mais aussi à l’académisme qui régnait encore dans une Ecole des Beaux-Arts de Paris toujours terriblement sclérosée. A Rouen, il a certainement subi l’influence d’un peintre figuratif subtil, à la thématique décorative et exotique brillante, Gérard Diaz. Une autre influence importante au cours de ces années d’apprentissage fut celle du peintre Gérard Garouste, grâce à qui il obtint une bourse de la Villa Médicis hors les murs en 1991. Le nom même de cette bourse en dit long sur l’obsession nationale de la respectabilité académique, mais le fait est qu’elle permit à Marrey de faire un premier séjour à New York. Au moment où le marché de l’art qui s’était emballé au cours des années 1980 connaissait un renversement de tendance puis une crise qui allait être durable, Gilles Marrey fit trois expositions à la galerie Kamouh rue Keller à Paris en 1990, 1991 et 1992. C’est l’une de ces expositions, probablement celle de 1991, les Sanguines, qui me permit de découvrir sa peinture.
Ces précisions de départ donnent le cadre dans lequel apparaît et se développe l’œuvre de Gilles Marrey. Celui-ci se forme durant les années 1980, durant la décennie postmoderne, au moins sous la forme hésitante qu’elle prend en France – Moderne mort ? Pas mort ? Immortel ? -. Il poursuit son travail dans les quinze années où s’achève le siècle de l’art moderne. Le contexte où il a à trouver ses marques est celui d’abord de l’ironie postmoderne, pour devenir ensuite celui d’une disparition des œuvres, et notamment, des peintures, au profit des images et dispositifs visuels de la société technologique – photos, vidéos, installations. On passe d’un contexte de mise en question plus ou moins réfléchie de la modernité à celui de pratiques qui n’ont plus rien de « moderne » et privilégient des appareillages de production d’images au service des émotions induites de manière immédiate par ces images. En disant cela, je n’exprime aucun jugement de valeur – j’essaie juste de décrire une situation.
La peinture de Gilles Marrey va et vient entre deux sortes de format et trois sortes de thèmes : d’un côté Marrey peint régulièrement de grands formats aux visées ou aux tonalités symboliques fortes, d’un autre il peint des peintures au format plus réduit consacrées à des scènes d’intimité ou d’imagination. A quoi il faut ajouter, plus récemment, les images de villes, aéroports, périphériques, tantôt en grands formats, tantôt aux dimensions plus réduites. On pourrait résumer ainsi les registres : symboles et allégories, intimités et affects et, troisièmement, ce qu’on pourrait appeler des lieux qui sont en fait des non-lieux. De telles catégorisations, aussi brutalement énoncées, sont forcément réductrices et artificielles, mais elles peuvent servir de point d’appui pour parcourir et considérer une production riche et ambitieuse.
Sources
Avant de le faire, il est important de revenir aux sources. Souvent les premiers énoncés, les premières déclarations d’intention d’un artiste fournissent un fil conducteur qui ne sera jamais tout à fait abandonné. Ce me semble être le cas pour Marrey dans le catalogue de l’une de ses premières expositions en 1991 avec un texte intitulé sans ambage « Qui a peur de la peinture ? ».
Que dit-il ? Que l’époque où il arrive s’est réfugiée dans le discours et le concept, qu’elle ajoute des commentaires au commentaire par peur des émotions procurées par une œuvre. Car le discours et le concept ont ceci de rassurant qu’ils excluent l’incertitude de l’artiste : celui-ci n’a qu’à suivre la ligne qu’il a projetée. Il peut sans risque « produire » des « pièces » en « série » au lieu d’affronter l’incertitude d’une peinture. Il peut se transformer en machine.
L’incertitude d’une peinture tient, au contraire, à la possibilité du ratage – par manque de savoir-faire, manque d’expressivité, manque de vérité, manque d’imagination. L’incertitude d’une peinture, c’est aussi celle du signe et du sens qui dépassent la forme et l’animent.
Marrey reviendra sur ces thèmes en parlant quelques années plus tard d’un art contemporain « désœuvré », qui joue sur le choc de l’inattendu et des habitudes de perception ou des conventions culturelles. A quoi il oppose une démarche picturale qui cherche à œuvrer en dépassant le stade de l’idée pour aller vers des objets autonomes, entiers, une démarche qui élabore des récits et des histoires pour parvenir à l’autonomie d’une peinture.
Plus tard encore, Marrey infléchit son analyse du côté de l’image. Il oppose alors l’image des mass-media qui doit aller toucher dans sa simplicité et sa pauvreté de stéréotype des millions de récepteurs à l’image picturale qui sédimente des images multiples et leurs affects en n’ayant pour destinataire qu’un seul individu et un point unique – le regard du spectateur.
Ces réflexions préliminaires n’ont rien de particulièrement nouveau. Ce qui est nouveau, c’est de les voir argumentées et défendues contre deux positions tellement dominantes qu’elles en ont fini par sembler naturelles, la vision processuelle et la vision technologique de l’art.
La vision processuelle de l’art vient de l’art conceptuel et du minimalisme. Elle substitue à la création de l’œuvre des procédures de production qui permettent de se débarrasser de la subjectivité, de l’expressivité, de l’unicité – de se débarrasser de l’œuvre tout court – pour ne garder que le projet artistique. Pas étonnant qu’une telle conception substitue des attitudes aux formes, des concepts au sens et qu’elle soit indissociable de l’espace d’un « monde de l’art » qui assure aux œuvres et à l’artiste leur « reconnaissabilité ». Pour l’artiste qui se transforme en machine, il faut en effet un espace d’identification qui lui permette de se différencier. Cet espace est fourni par les acteurs des mondes de l’art. Cette vision processuelle n’est pas condamnable par principe. On pourrait même lui trouver comme justification qu’elle ait pu coïncider avec des préoccupations d’époque qui allaient du rejet du pathos expressionniste ou gestuel à la doctrine de la mort de l’auteur, avec probablement aussi une bonne dose de nostalgie pour ces puissants mouvements de masse qui échouaient en politique ou prenaient un visage grimaçant d’oppression. Il n’est pas non plus inintelligible qu’un jeune artiste n’en veuille à aucun prix et revendique au contraire son droit à la subjectivité, au sens et aux symboles.
La vision technologique est plus insidieuse car beaucoup moins théorique : elle consiste seulement pour les artistes à se laisser porter par les moyens visuels du temps, à faire ce que les moyens à disposition leur permettent de faire.
Le fait est qu’en moins de deux décennies, entre 1980 et 2000, nous avons changé fondamentalement de régime d’image.
Déjà au XIXe siècle, la situation avait été bouleversée une première fois par des changements techniques que l’on pensait radicaux et indépassables. Les temps où l’humanité fut pauvre et même indigente en images étaient si lointains qu’ils en paraissaient incroyables : qu’est-ce que cela pouvait bien signifier la pénurie d’images, de moyens de reproduction et même de miroirs, pour les hommes des temps de l’affiche publicitaire, du cinéma et de la photographie ? Est-ce que cela pouvait avoir un sens de parler d’hommes pour qui la vue aurait moins compté que l’ouïe ou le sens du toucher pour des spectateurs du XIXe siècle qui pouvaient donner libre-cours à leurs instincts de voyeurs ? Un historien des mentalités comme Robert Mandrou a pourtant noté que même les hommes du XVIe siècle avaient du mal à voir les tableaux tant la représentation perspective était pour eux nouvelle et bizarre, et que les écrivains du temps, sans exception, de Rabelais à Montaigne, rapportaient des propos sans jamais décrire leurs personnages tant la vision était encore pour eux un sens perceptif accessoire…
Une autre révolution est intervenue avec le numérique, c’est-à-dire la reproductibilité illimitée accessible à chaque individu ou presque avec son appareil de photo numérique, sa caméra vidéo, son téléphone et toutes les facilités du téléchargement. Le résultat est simple et brutal : les images ne sont plus à regarder ou à craindre, elles ne sont même plus fascinantes comme ont pu l’être les images cinématographiques des années 1930. Les images sont désormais à consommer et à jeter. Ce qui ouvre sur un nouveau régime perceptif mêlant balayage incessant et inattention, distraction et aveuglement les yeux ouverts, un régime perceptif où nous baignons dans les images sans plus les regarder : on ouvre la télévision comme on ouvre la lumière, comme s’il s’agissait d’une source lumineuse de plus, ou d’un appareil de chauffage, et nos images sur les caméras de surveillance nous accompagnent comme, jadis, les anges gardiens.
Assorti à un nouveau monde technologique, ce nouveau régime perceptif va de lui-même – il est évident et normal. En art, il rend possible un monde d’installations et d’images mobiles, en apportant une sorte de renouveau du panorama enrichi technologiquement. Il n’y a plus à voir mais à sentir, éprouver, expérimenter. Quoi ? Des ambiances, des atmosphères. L’art de l’époque hypervisuelle est paradoxalement moins visuel qu’environnemental. Ce qu’il y a à voir, pour paraphraser en le déformant le peintre Frank Stella, n’est pas ce qu’il y a à voir mais ce qu’il y a à éprouver, y compris sous des formes de stimulations sonores et lumineuses comme on peut les trouver dans les night-clubs.
On comprend qu’une génération entièrement élevée dans la bulle sonore des fichiers numériques et la réalité virtuelle des images vidéo se sente de plain-pied avec ces expériences, qu’elle n’ait plus besoin d’ouvrir les yeux ni de faire attention, pas plus dans un musée que pour traverser la rue.
On comprend aussi qu’un certain nombre d’artistes aujourd’hui, dans toutes sortes de domaines, allant de la peinture la plus classique à des formes d’art cognitives, post-conceptuelles ou biotechnologiques, en ait assez et plus qu’assez d’un art hyperesthétique ou, mieux encore, esthésique au sens où il n’est question que de sentir et de vécu, d’un art voué aux expériences et aux stimulations au détriment de l’imagination, de la connaissance ou de l’attention. Marrey fait partie de ces artistes et il fait passer son désir par l’appel à l’imagination, à la perception attentive, au plaisir pictural. Il veut s’adresser à des individus isolés en leur proposant une expérience complexe à regarder.
Allégories et enchantements
A ses débuts dans les années 1990, Gilles Marrey est très marqué par Delacroix, Gauguin, Munch, par le symbolisme, les couleurs du fauvisme, mais aussi par les peintures de l’intimité de Bonnard et Vuillard (il serait injuste d’oublier une influence contemporaine bien présente, celle de Gérard Garouste).
J’ai tout de suite été saisi par les grandes compositions métaphysiques de Marrey au début des années 1990, incendiées par une force décorative somptueuse. Des tableaux comme Le Pêcheur (1989), Les Corbeaux (1990), Le Chien jaune (1991) sont des tableaux où le cadrage des personnages et la composition du décor contribuent à créer une scène énigmatique et onirique, peut-être une scène d’opéra inconnu, sur des fonds d’incendie colorés. En même temps, Marrey a pratiqué tout de suite un autre registre, celui des enchantements picturaux recherchés pour eux-mêmes, qui réunissent et tressent ensemble, comme chez Bonnard ou Vuillard, des moments de vision, de sensation et d’émotion. A vrai dire quelques peintures de très grand format (plus de trois mètres par deux) encore plus anciennes, des peintures d’étudiant pourrait-on dire, lui avaient permis de s’exercer au jeu des hommages sur ce registre avec des titres comme La bibliothèque rouge (1987) ou A la recherche du Bonnard perdu (même date).
Quand je dis « enchantements picturaux », ce n’est pas une simple manière de parler : j’entends une relation matérielle à la peinture, à la planéité de la toile et au basculement de cette planéité dans la représentation par la seule vertu de l’illusion, comme on les trouve effectivement chez Bonnard et Vuillard.
Gilles Marrey est resté fidèle à cette dualité, même si les thèmes ont évolué.
En 1994, un immense tableau, La Peste (500 cm sur 200), reprend le projet de la grande peinture allégorique et de la peinture religieuse à visée de dénonciation du mal. En 1997, sans complexe par rapport à Courbet, Marrey peint sous le titre L’Atelier (Les Pas perdus) son atelier à lui, une toile d’environ 600 sur 300 cm, où il ne tente ni plus ni moins que de rassembler les expériences visuelles et les vécus du peintre dans l’atelier qu’il a occupé durant quatre ans et dont il peint la mémoire avant de le quitter. En 1998, il montre son Grand Périphérique (160 par 400), qui sera suivi par de grands tableaux d’aéroports et de villes dans les années 2000.
En même temps, avec continuité, Marrey peint aussi des scènes d’intimité et d’intérieur.
Sur le double registre du Proche et du lointain ou du Soleil et de la Lune (ce sont les titres de deux expositions en 1994 et 1995), sa peinture ne cesse de s’ouvrir à l’extérieur et de revenir vers la subjectivité la plus intime.
Ensuite ce sont encore des peintures de la vie et de la proximité qui le retiennent. Elles sont consacrées aux bonheurs quotidiens, aux vues d’atelier, ou encore ce sont des scènes prises dans les cafés, parfois des scènes de couple qui sont en fait des scènes érotiques de chambre d’hôtel.
Dans les grands peintures « à thème » comme dans les scènes plus quotidiennes, Marrey a la même démarche picturale.
L’exemple de la grande peinture de L’Atelier est très parlant.
Dans cette très grande toile de 1997, Gilles Marrey entreprend, tel le Courbet de 1855, de convoquer le monde dans la représentation du peintre. Ce monde est celui de sa vie des dernières années en même temps que l’espace visuel de cet atelier où tant de choses sont arrivées, où tant de peintures ont été faites, tant de personnes et de sentiments sont passés. La toile est une sorte de panorama distordu ou de collage de ces moments et sensations. Chaque moment y est rendu avec sa perspective, ce qui exige un effort pour rendre cohérent l’ensemble de ces points de vue particuliers. Gilles Marrey a voulu figurer cette salle des pas perdus qu’est un atelier, tout ce qui s’y passe et tout ce qui y passe, avec un rassemblement de l’espace, depuis le canapé défoncé du fond de la pièce jusqu’aux pinceaux et aux escabeaux devant les toiles, depuis la porte d’entrée jusqu’au mur où se peignaient les toiles en passant par la suite des fenêtres sur le côté. Autant de choses à composer, sédimenter, rassembler. Mais il y a plus : il faut aussi rassembler les temps et les moments de la lumière : lumières du soir venues de la rue et des enseignes de l’hôtel et des restaurants en face, à travers la rue, lumières de fin d’après-midi, lumières du matin. La toile est ainsi une tentative pour figurer un cycle, cycle des parcours dans l’espace de la pièce, cycle des jours, cycle du temps passé en quelques années avec les événements de la vie. Sur la toile de son Atelier, Marrey a collé « pour de vrai » des fragments et souvenirs, mais aussi il a introduit des images de certaines de ses peintures des dernières années, fragments de nature morte et de paysage. L’effort du peintre (et la réussite de la peinture) consiste à tout mettre ensemble, à recoller les morceaux, à faire la synthèse de la vie en une peinture mouvementée.
Dans un texte à caractère de manifeste de 1994, Marrey insistait sur le caractère de récit de la peinture, sur sa nature de construction de relations entre les éléments, mais il insistait aussi sur le défi de l’organisation et sur l’équilibre précaire ainsi atteint. Avec la conscience claire que ça peut être raté, que la disparité peut rester insurmontable, que l’unité peut ne pas se faire – et que c’est précisément en cela que consiste la vérité de la peinture.
Autour de la grande toile de l’atelier, à la même époque, on voit ainsi un certain nombre de ces moments singuliers qui ont été repris et synthétisés dans le « défi de l’organisation » – mais c’était déjà la cas quand, au tout début, Les Fruits (1991), La Théière (1991), Le Miroir (1991) accompagnaient les peintures symbolistes dont j’ai déjà parlé.
Plus tard et jusqu’à aujourd’hui, les scènes d’intimité, de vie quotidienne, de fiction érotique et même les scènes urbaines sont fidèles à ce projet de composition et de sédimentation picturales des moments et sensations.
Ainsi dans les scènes de café de 1998, il s’agit de mettre ensemble des moments et des groupes de personnages différents dans l’espace.
Physiquement et architecturalement, l’espace d’un café est conçu pour à la fois isoler des personnes, leur laisser un minimum d’intimité et les réunir dans un espace public. Il y a là un espace de convivialité qui préserve des bulles d’intimité où naissent les romances, s’échauffent de grands projets, s’échangent des banalités, se croisent des tensions et se négocient des ruptures. Ce qui donne aux architectes d’intérieur et aux peintres un problème du même ordre : comment à la fois rassembler et isoler. A quoi s’ajoute pour le peintre une sorte de plaisir d’Asmodée à surprendre des intimités, à les débusquer, à les faire voir (la fille à la robe rouge, celle qui écrit des cartes postales, les deux amies du Balto) et à les placer dans l’espace public, à les faire voir en les rendant visibles. Depuis Manet, il y a là plus qu’un sujet de la peinture : un exercice de mise en espace, de passage du privé au public. Qu’on songe à La Buveuse d’absinthe, à Un Bal masqué à l’opéra et à Un Bar des Folies-Bergère.
Les chambres d’hôtel renvoient à autre chose : l’imagination du voyeur et le piège de l’image, mais l’imagination est ici encore une puissance de rassemblement des fantasmes.
A première vue, si on ne se laisse guider que par les dimensions, on serait tenté de dire que ce sont des toiles plus petites (140 cm par 140 ou quelque chose comme cela) – mais on se ravise aussitôt. Car il ne s’agit plus de peindre un coin d’atelier ou un espace public. Ces toiles si fermées sur un sujet, sans espace ni respiration, ces toiles de corps à corps, sont, par comparaison avec les autres, grandes au point d’en être asphyxiantes. L’Atelier rassemble, convoque et synthétise un monde d’espaces, de moments et d’expériences. Les Cafés juxtaposent, les Hôtel enferment.
Gilles Marrey a occupé durant quelques années un atelier en face d’un hôtel. Il a imaginé et fantasmé toutes les scènes de sexe qu’étrangement il n’a jamais vues – je dis étrangement parce que les fenêtres restaient obstinément closes et les rideaux tirés. Qu’est-ce qui se passait derrière ces rideaux toujours tirés ? Rien ou des choses brûlantes ? Dans un texte de 1991, Marrey parlait de l’imagination, de la faculté du peintre à projeter sur la moindre tache « une silhouette, un arbre, un signe ». Les Hôtel reviennent à ce thème sous la forme de la création de scènes imaginaires, mais ils y reviennent picturalement. Marrey a choisi la solution de traiter ces scènes d’érotisme de manière dense, touffue, en maintenant une concurrence tendue, difficile, entre l’image elle-même et les effets de peinture, en fermant aussi l’image dans un espace resserré, asphyxiant, sur un fond d’où elle se dégage difficilement. Il lui fallait à tout prix neutraliser le cliché pornographique s’il voulait non pas éviter la pornographie (ce n’est pas vraiment son intention), mais ne pas se faire éjecter de la peinture. C’est pourquoi ces scènes pornographiques sont au bord de l’abstraction, au bord de la matérialité picturale, laquelle, avec son caractère régressif (la saleté de la peinture et de la couleur), renvoie à son tour à la pornographie en tant que matière, humeur, déchet.
En fait, dans ses scènes d’intimité et d’intérieur comme dans ses « grandes » peintures Marrey s’efforce de tenir à distance les sentiments faciles en les ramenant à la peinture, c’est-à-dire à la matérialité du support.
S’il s’en tenait à des effets picturaux en rapport avec la tradition dont il se réclame, en rapport aussi avec le cadrage photographique et les matériaux de la peinture (couleurs, pigments, gestes et traces du pinceau), on aurait affaire à un maniérisme figuratif qui prend ses distances avec son contenu. Cela donnerait quelque chose comme une réflexion cultivée et picturale sur l’histoire, avec ou sans contenu allégorique, comme on en a vu plusieurs au cours de l’épisode postmoderne, par exemple chez Tansey ou Morley. Si, à l’opposé, il se laissait complètement prendre par ses sujets et ses thèmes, avec leur charme et leurs sortilèges, l’immédiateté de l’image prévaudrait. En fait Marrey à travers imagination, défi de l’organisation et moyens matériels de la peinture maintient un équilibre fragile et instable entre le fait de la peinture et celui du sujet. La figuration est chez lui l’effet d’un travail constant, une opération, pas une image donnée comme effet et résultat.
Les non-lieux
Le changement le plus important chez Gilles Marrey dans les dernières années, c’est l’apparition de grandes peintures de ville et d’espace urbain au détriment de la veine symboliste et allégorique .
Marrey a commencé par aborder ces nouveaux thèmes à travers des scènes de rue entre chien et loup, des vues de gare et de quais parisiens. Il s’agissait de lieux de passage et de transit, assez vides, avec un mélange de proche et de lointain – à peine des lieux, mais encore familiers et habitables par des citadins. Il a ensuite franchi le pas en choisissant véritablement ce que l’on appelle depuis Marc Augé des non-lieux : les boulevards périphériques, les couloirs et salles d’attente des aéroports, la ville vue depuis les étages élevés d’un hôtel, tous ces espaces que nous traversons sans pouvoir y résider ni les habiter, où nous ne faisons que passer avec quelque anxiété ou une fausse désinvolture. On passe sous les tunnels et souterrains du périphérique, on attend son avion dans une salle d’aéroport, on habite une tour du Front de Seine ou un quartier de Manhattan mais pas le Front de Seine ni Manhattan et la présence dans la chambre de l’hôtel n’aura de réalité que fugace. Si des écrivains ont pu habiter leur vie durant une chambre d’hôtel de quartier, on n’habite pas au Hilton.
Ces peintures ont donc pour sujet le passage, le vide, la transparence des vitrages, la fonctionnalité des éclairages et des lumières, l’organisation à la fois forte et illisible des structures architecturales. Ce que l’on y trouve de présence humaine se limite à des personnages qui se reflètent sur les vitrages, à quelques silhouettes pressées, ou à des objets qui témoignent d’une présence, comme le rétroviseur brouillé de la voiture engagée sur le périphérique et d’où la vue est saisie. Bien sûr, Marrey continue de jouer là sur la dualité de l’image et de l’effet pictural, sur la manière dont une plage de couleur devient une cellule de gratte-ciel ou dont, au contraire, un morceau d’architecture se dissout en passage de brosse.
Il me semble qu’il y a là en fait des allégories réelles du temps et de l’époque. Alors qu’auparavant, encore porté par les références du passé, Marrey entreprenait de peindre des scènes d’opéra ou des fragments de mythe, désormais il nous confronte à un réel qui n’en est pas un, à des lieux qui n’en sont pas et qu’il nous faut bien habiter quand-même, c’est-à-dire tout juste traverser, que ce soit pour de bon dans une automobile ou en tirant une valise sur ses roulettes. Courbet a intitulé son fameux Atelier de 1855 « allégorie réelle déterminant une phase de sept années de ma vie artistique » et l’on s’accorde à comprendre cette expression d’allégorie réelle comme la nécessité de saisir les personnages et objets qui entourent Courbet aussi bien comme personnes réelles que comme symboles. Quand je parle d’allégorie réelle à propos des « non-lieux » peints par Marrey, il y a quelque chose de similaire. Ces non-lieux sont bien réels, et même suprêmement réels : ils appartiennent à notre quotidien. En même temps, ce sont des symboles de notre monde, de notre existence dans ce monde de passage inhabitable. Nous avons bien les deux à la fois – le réel et ses symboles. On sent bien que Marrey est désorienté par ces « paysages » – parfois il peint encore les toits de Paris comme s’il rêvait d’une ville. Mais en choisissant ces vues de métropoles, il confronte la peinture à une perte de sujet qui est tout à la fois perte de l’intimité, perte de la possibilité d’habiter et présence en quelque sorte oppressante d’un nouvel espace. La scène allégorique est perdue. La scène réelle est absorbée par ces espaces. C’est en eux que désormais il faut trouver à inscrire l’intimité – un reflet dans une vitre.
Une Poétique
Pour finir, je voudrais dire quelques mots du débat que l’on attend aujourd’hui s’agissant d’un peintre figuratif, même si ce débat est finalement ritualiste et éculé : à quoi peut bien correspondre ce qu’il fait ? Qu’est-ce qui peut le justifier, l’expliquer, lui donner sens ?
Comme je l’ai dit à propos des réflexions de Gilles Marrey, il s’agit pour lui de défendre la valeur de l’incertitude et la place de la fragilité. Lorsqu’il terminait son grand Atelier, Marrey me disait qu’il ne savait pas s’il y arriverait. Les artistes qui travaillent selon un système conceptuellement défini, y compris les peintres à programme, n’ont pas d’incertitude sur le fait de pouvoir y arriver. Tout au plus peuvent-ils se retrouver avec une pièce qui, comme on dit, ne marche pas, ne fait pas entièrement, ou pas bien, son effet. S’il y a tellement de pièces d’art contemporain médiocres, c’est parce qu’elles obéissent au paradoxe d’être forcément réussies (il suffit de suivre la règle de production) et que pourtant elles ne marchent pas forcément. L’incertitude est au niveau de leurs effets, pas de leur production. A l’opposé, une peinture ne rate pas son effet : elle est ratée tout court. Il ne s’agit pas de savoir si elle est bien ou mal présentée, si l’espace qui la reçoit est adéquat, mais si elle est ou non réussie. Il y a là deux régimes de production très différents qui sont au cœur des discussions actuelles sur l’art contemporain où s’opposent des partisans du risque et de la fragilité et d’autres qui valorisent l’autonomie et le caractère mécanique des démarches de production. C’est pour cela qu’une défense de la peinture au nom de la valeur du métier tombe mal : elle renvoie, elle aussi, à une logique du procédé, cette fois académique, et ne se distingue guère de ce qu’elle critique dans l’académisme moderniste.
Il serait donc erroné de voir en Gilles Marrey un peintre de tradition par goût du métier. Ce qui le préserve de l’académisme, c’est le risque pris dans le choix des thèmes, dans les entreprises de figuration, y compris en termes des références choisies. Entre l’ambition de L’Atelier, les fantasmes de la pornographie, le vide des paysages urbains, et les espaces d’intimité, Gilles Marrey veut donner sa place à un art visant la fragilité de la vision et l’attention du regard. La dimension principale de sa recherche est donc avant tout poétique.
Yves Michaud, le 28 février 2006.
Texte paru dans le catalogue « Introspective », éditions Actes Sud / Musées de Sens