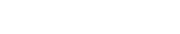Lorsque Gilles Marrey passe, sur les conseils de son parrain le sculpteur Maxime Adam-Tessier (1920-2000), le concours de l’école des Beaux-Arts de Rouen en 1981, la tendance générale de l’enseignement est celle de l’abstraction froide, Jacques Poli (1938-2002) ; de la sculpture minimale, Jean-Marie Bertholin (né en 1938), et de l’art conceptuel, sous la tutelle bienveillante de la revue Art Press éditée en noir et blanc. Virginia Whiles-Serreau, professeur d’histoire de l’art, ne jure que par la « nouvelle sculpture anglaise », décide de reprendre l’histoire de l’art à rebours, organise des voyages et des séjours scolaires au London College of Communication et Royal College of Art de Londres, à Prague, Berlin, Florence, et à Venise où Gilles s’éprend déjà de grand format vénitien. Lorsqu’une des étudiantes passe son examen de troisième année en présentant des photographies de concerts rock et de sa bande de copains, elle s’entend rétorquer « Ça n’intéressera jamais personne vos photos ! ». Les années 1980 seront pourtant celles de la photo plasticienne, celles de l’ « école de Boston » d’où est issue Nan Goldin (née en 1953), qui photographie son milieu, ses amis, et dont le travail est aujourd’hui considéré comme le miroir d’une époque. Malgré une tendance conceptuelle de l’enseignement, légitimée sans doute à Rouen par la présence tutélaire de Marcel Duchamp, une émulation se crée autour d’une poignée d’étudiants déterminés à en prendre le contre-pied par la pratique de la peinture figurative et du dessin à vue. Ils sont férus de peinture moderne, de celle de Gauguin, Manet, ou Vuillard, et surtout de celle de Bonnard que Gilles eut la chance d’explorer in situ grâce à la rétrospective Beaubourg de 1984, passionnés de peinture classique aussi, celle que le jeune homme peut contempler à l’envie, en trouvant refuge devant le Bain de Diane de François Clouet (v. 1559-1560) ou le Démocrite de Diego Velázquez (v. 1630) des collections permanentes du musée des Beaux-Arts de Rouen. Parmi les contemporains, Gilles s’intéresse tout particulièrement à Eric Fischl (né en 1948), qui dénote dans le paysage artistique de l’époque par son réalisme figuratif grinçant, la place et le rôle qu’il accorde au nu, et le regard sans complaisance, qu’il porte sur son époque.
La toute nouvelle tendance à laquelle appartient Gilles, accorde une place prépondérante au modèle vivant et aux mythes, créant même de nouvelles fables à partir de la culture de la rue, du cinéma d’art et d’essais et plus largement de la subculture contemporaine : les radios libres, le magazine Actuel, les fanzines, les squats, le punk, etc. Mais le plus important est qu’elle s’intéresse à la peinture. Ces jeunes gens saturent désormais de grandes toiles fixées sur les cimaises des ateliers, de couleurs sorties des tubes et des pots d’acrylique, barbouillent, frottent, sur fond de musique underground, celle du Velvet, de la No Wave, du « garage-punk », celle de la scène locale (1), celle aussi des opéras classiques et des symphonies « mahlériennes », dans ce lieu insolite qu’est cet ancien cimetière-charnier de l’aître Saint Maclou de Rouen. C’est dans ce terreau fertile, que la peinture de Gilles Marrey trouve ses racines, un terreau déjà aéré par le milieu familial. À l’âge de 12 ans, Gilles s’initie pendant les vacances passées avec sa mère et son père homme de lettre, Baptiste Marrey (né en 1928), à la gravure sur bois chez le peintre Louttre B (1926-2012) (2), un intime dans les années d’après-guerre, de Nicolas de Staël. Ce qui lui vaut de montrer dès sa première année d’école quelques appétences et aptitudes dans ce domaine. C’est à partir de sa troisième année d’école qu’il se met à peindre des grands formats. Une pratique qui ne le quittera plus jusqu’à aujourd’hui, alternant en permanence petite et grande dimension, dessin et peinture, monotypes et polyptiques.
La consécration de la « Transavantgarde » (3) italienne à la quarantième Biennale de Venise en 1980 ; l’ouverture au Centre Pompidou (4), à la fin de la même année, de l’exposition Les Réalismes, entre révolution et réactions, 1919-1939, regroupant des œuvres ayant en commun le rendu imitatif de l’aspect extérieur du réel, le fignolage et le beau métier ; des peintres comme Anselm Kiefer (né en 1945) , Georg Baselitz (né en 1938) ou Markus Lüpertz (né en 1941) en Allemagne ; Julian Schnabel (né en 1951) et Jean-Michel Basquiat (1960) aux États-Unis, ou Gérard Garouste (né en 1946) en France, témoignent d’un retour de la peinture figurative sur le devant de la scène internationale à l’entrée des années 1980. Produit d’une remise en question de la vision déterministe et progressiste de l’art moderne, prenant le contrepied de l’idée d’un déclin de la peinture au profit d’une succession des mouvements d’avant-gardes, ce « retour » sonne comme la libération d’un refoulé, celui de l’extériorisation de soi à travers une peinture figurative « néo-expressionniste » de grand format où s’imposent la gestuel picturale, de grandes zones abstraites et dégoulinantes, et dans laquelle évoluent des formes géantes brossées à grands traits.
Les premières peintures de Gilles s’inscrivent dans cette tendance. Rien d’étonnant à ce qu’il soit repéré par Gérard Garouste, qui trouve dans la peinture du jeune artiste de fortes affinités avec la sienne. On est en 1991, Gilles vient tout juste d’obtenir son diplôme (1988). Il s’apprête à exposer à la galerie Pierre Kamouh, rue Keller à Paris, avec ses deux compagnons d’étude, Hervé Heuzé et Thierry Basse (5) qui, reconnaissant Garouste chez Sennelier, l’invitent à leur vernissage. À partir de ce moment, Garouste porte une attention bienveillante au travail de Gilles, lui présente son collectionneur Jean Hamon, rédige la préface du catalogue de la dite exposition (6), soutient sa candidature à la Villa Médicis hors les murs que finalise un séjour de neuf mois à New-York, à l’origine sans doute de ses représentations d’espace urbains, de vues plongeantes, de ciels et de vide dans ses toiles des années 1990. D’une manière générale cette décennie est marquée par l’utilisation des terres d’ombres brûlées, que l’artiste semble recouvrir avec un plaisir jubilatoire, de jaunes, de bleus, de rouges, de blancs colorés, délimitant à l’aide de ses brosses, des silhouettes, des nuages, des reflets, des lumières, des escaliers, faisant apparaître, ou disparaître des personnages, au café, aux terrasses, des femmes au lit, posant ou surprises dans l’intimité d’une chambre. À la fin des années 1990 et dans les années 2000, les espaces qu’il dépeint se vident de toute figuration humaine, frôlant les limites de l‘abstraction, valorisant les lignes de composition de l’image. Les tarmacs, tunnels, gares et aéroports hantent sont univers pictural.
Le modèle occupe pourtant, et continue d’occuper une place prépondérante dans son travail. Les visiteurs qui viennent à l’atelier sont croqués, tandis que l’atelier fait lui-même l’objet d’un immense tableau [L’atelier ; Les pas perdus, 1997-1998, 288x 640 cm], opérant selon l’expression de Catherine Millet à propos de l’art contemporain, une « soudure » entre création du passé et celle du présent. Sa toile renoue avec la grande tradition, celle qui, de la Renaissance à aujourd’hui, offre son lot d’images, autoportraits, photographies, reportages où se dévoilent les mystères de la création. La représentation de l’atelier participe à la création de sa propre mythologie. Celui de Gilles absorbe le spectateur par ses dimensions, s’ouvre comme un grand livre, révèle au regard l’intimité de la création. Impression d’autant plus forte que le geste et l’écriture picturale y sont eux aussi dévoilés et franchement lisibles. Le Salon Noir est une sorte de variante pertinente de la représentation de l’atelier, témoignant entre autres œuvres, de son omnipotence dans la vie et l’iconographie du peintre. Commencée à l’automne 2009, non encore achevée, véritable work in progress (7), d’une dimension admirable, superposant lieu de vie et lieu de création, ce projet regroupe la représentation d’amis, de proches, d’objets familiers, telle la tasse Beatles. Elle laisse entrevoir à qui sait déchiffrer les références artistiques, le regard porté de longues heures durant sur les nature mortes des musées, la place qu’occupe dans les tableaux, les reflets dans les surfaces miroitantes et autres sorcelleries et subterfuges de la peinture. Une chose frappe notre attention, la grande maîtrise acquise pendant toutes ces années de « non renoncement » au médium pictural, visible dans l’usage que fait Gilles du noir, l’obscurité qui revient comme un leitmotiv, traversant presque toute l’œuvre du peintre. La vaste toile est composée de plusieurs tableaux : le chat sur le t-shirt de la fillette debout dans les escaliers et dont la silhouette se découpe sur un rectangle rouge, lequel se détachant du fond noir de la toile ; l’autoportrait à gauche, la fenêtre qui ouvre sur le paysage urbain vue de nuit, les groupes de personnages, le reflet dans la boule d’aluminium, la nature morte du premier plan ; bref une unité morcelée que renforce la constitution de la toile en polyptique. Ces « tableaux » fonctionnent indépendamment l’un de l’autre, et s’harmonisent grâce au noir du fond. C’est là que se trouve une des grandes difficultés de la peinture, ordonner, harmoniser, rendre les incohérences, cohérentes. La fillette de gauche, c’est Lila, une de ses filles, point de départ de cette grande entreprise. Elle est aussi celui du grand dessin Médusa, créé expressément pour l’exposition de Gilles Marrey au musée des Beaux-Arts de Rouen.
Le mythe raconte qu’une belle jeune fille, Méduse, fut séduite et violée par Poséidon dans le temple d’Athéna, puis transformée par la déesse en créature malfaisante et maléfique, à la chevelure de serpents et au regard pétrifiant, la Gorgone. De sa décollation par Persée, jaillit un sang qui engendra deux fils, Chrysaor, père de Géryon, le géant à trois têtes, et Pégase, le cheval ailé. Fixée sur le bouclier et l’égide de la déesse d’Athènes, elle devient talisman, l’emblème d’Athéna, le « gorgonéion », mot qui désigne « la figure fixée d’un original vivant mais inaccessible au regard » (8). Méduse ne devenant supportable à la vue qu’en tant qu’eikôn9, car même morte, elle pétrifie. Méduse transformée en Gorgone puis décapitée devient image, Médusa est une image. Figurer Méduse équivaut à figurer la représentation. Représenter son atelier, c’est se représenter en artiste, c’est faire son autoportrait, se dévoiler aux autres. L’art ne serait au fond qu’une révélation de ses procédés, une confidence aussi, de celui qui peint. « Peindre, c’est se peindre ».
L’iconographie de Méduse qui nous est la plus familière, et qui jalonne l’histoire de l’art de l’antiquité à aujourd’hui, est celle de la tête coupée de la gorgone. Méduse conjugue toutes les ambigüités, elle est à la fois fascinante et repoussante, tout comme l’est l’animal aquatique marin dont l’analogie formelle d’avec la tête coupée du monstre femelle, explique l’homonymie vernaculaire. La ressemblance ne s’arrête pas là. Grâce à ses cnidocystes l’animal paralyse. Figurant à plusieurs endroits du grand dessin de Gilles, elle est le titre qu’a choisi l’artiste pour désigner son travail, comme l’avait fait avant lui un peintre né à Rouen, Théodore Géricault (1791-1824). Est-ce un hasard ? Parce qu’on ne peut envelopper ces deux images d’un seul regard, faire l’expérience du grand tableau de Géricault, et de Médusa nous amène à la sensation de sublime. Les deux images nous dépassent physiquement. Gilles ayant choisie de présenter Médusa dans l’obscurité –telle Gorgone cachée à la vue de Persée dans l’obscurité de la grotte-, son œuvre se refuse au regard. Elle ne se dévoile qu’à l’aide d’une lampe torche et ce, d’une manière morcelée. Coloriées d’une couleur luminescente, ses méduses seront les seules éléments du dessin visibles, après le passage de la lumière, lorsque le noir -décidément encore lui-, sera revenu dans la pièce. Regarder, ne rien voir. Prendre conscience que ce que nous regardons est une image. Ne rien voir et laisser surgir de notre inconscient les images intérieurs que l’absence de lumière, le titre de l’œuvre ou les traces d’images laissées après le passage de la lumière impriment encore sur notre rétine.
Gilles raconte au sujet de Médusa un souvenir d’adolescent aux apparences de rêve. Il est en méditerranée, le soleil brûle, pas le moindre souffle de vent pour faire avancer la planche à voile sur laquelle il se tient. Tout est immobile. Seules évoluent autour de lui les méduses géantes qui l’effraient et le fascinent. Il est sidéré. Tout comme le sont les deux personnages de son dessin, tournés tous deux vers la même source lumineuse. Cette situation est à la fois angoissante et merveilleuse, une sorte de voyage initiatique, d’épopée contemporaine. L’idée de créer une toile dont le sujet serait la méduse lui trottait déjà dans la tête lorsqu’il était à l’école. Quelques dessins, une peinture, une lithographie en témoignent. L’invitation à venir exposer à Rouen offrait l’occasion rêver de finaliser le projet, de boucler la boucle, d’opérer une soudure. La présence de ces créatures dans son gigantesque dessin (640 cm de large) inquiète par leur incongruité dans le paysage. Comme le souvenir de Gilles, le dessin dans son entier engendre un sentiment d’inquiétante étrangeté, car nous sommes tiraillés entre la contemplation d’une technique époustouflante et le malaise provoqué par le rapprochement d’éléments inadéquats, tel ce garçon qui chevauche le squelette d’un cheval, ou ces méduses qui flottent dans un environnement terrestre. Gilles se plaît à troubler notre perception en introduisant « un facteur de déstabilisation » dans ses tableaux, une prairie dans un paysage urbain ; un animal aquatique dans un univers champêtre ; un lièvre dans un salon (fig.). Lièvres et méduses invitent certes à une interprétation érudite et cultivée, mais aussi plus directe, primitive et animale. Il nous vient à penser que Gilles est un homme qui brode, qui ajoute au fur et à mesure, superpose et commet des éléments appartenant tour à tour à des univers différents, à sa vie privée, à l’histoire de l’art et à celle de la représentation, mais qui créé aussi des intervalles, entre les éléments qu’il convoque sur l’image et pour faire image, matière, couleurs, composition…, entre la représentation des choses et l’idée que le spectateur se fait de ces choses représentées. L’artiste arachnéen créé des flux immatériels, fabriquant de cette façon de nouvelles fables. Ce sont ces flux qui font œuvre.
Corinne Laouès
Texte paru dans le catalogue « Le grand Salon noir », éditions Carpentier, 2014
- Rouen connait dans les années 1980 un véritable bouillonnement de sa scène alternative rock. La ville fut une des principales têtes de pont de « l’invasion punk » en France, et dès 1977, le groupe Clash y donne un concert. Sa scène locale : Les Dogs ; Les Olivensteins [dans lequel on trouve deux petit-fils du peintre Maurice Denis (1870-1943)] ; Les Flics; Les Nurses; Les Gloires Locales,… auxquels il faut ajouter le magasin de disques Mélodie Massacre et le club l’Exo 7, où se produisirent, Iggy Pop, Les Cramps, Les Cure, Alan Vega, Tuxedomoon, les Virgin Prunes…, eurent un impact et occupèrent une place considérables sur la scène artistique de l’époque. Gilles fut particulièrement impliqué dans tout cela, cherchant à retrouver dans les arts visuels la même intensité et la même énergie, qui régnaient dans et autour des concerts.
- Marc Antoine Bissière, fils de Roger Bissière. Lauréat de la deuxième Biennale de Paris en 1962.
- La Transavantgarde italienne, créée en 1979, par Nicola de Maria, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Francesco Clemente et Mimmo Paladino, revalorise la peinture figurative, l’imaginaire, le « territoire culturel » de l’individu amené à puiser dans la mémoire de son passé, la réappropriation des mythes et des images.
- Le Centre Pompidou ouvert depuis 1977 avec une exposition Marcel Duchamp suivi sur le plan muséographique de l’incroyable exposition Salvator Dali, comptait déjà à son actif les expositions « Paris-New-York » 1977 ; « Paris-Berlin », 1978 ; « Paris-Moscou », 1979 ; « Paris-Paris » 1981, considérées aujourd’hui comme des événements qui ont fait date, et qui n’ont pas manquées d’attirer l’attention des jeunes étudiants en art de l’époque, sur la peinture moderne.
- Le décor mural qui se trouve dans le hall de la gare de Rouen rive droite et représentant le mythe du Minotaure a été réalisé par ces deux artistes.
- Gérard Garouste, in Gilles Marrey. Les Sanguines, peintures, Paris, galerie Pierre-Kamouth, mars 1991.
- Le Salon noir est une grande toile composée de plusieurs parties, un polyptique en quelque sorte. Elle est, de plus, complétée de toiles aux dimensions plus modestes chaque fois qu’elle est exposée, toiles que l’artiste nomme Petits salons, sortes de conversations privées, le plus souvent entre deux personnes. Ainsi existe-t-il autant de Petits Salons que d’exposition du Salon noir.
- Julia Kristeva, Visions capitales, arts et rituels de la décapitation, éditions Fayard et de la Martinière, 2013, p. 31